DE LA GUERRE
Dr Valérie LADEGAILLERIE ISBN 979-10-96025-44-2  De la guerre
De la guerre 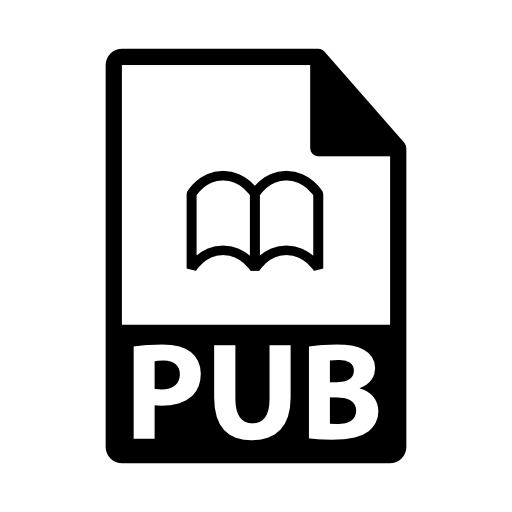 De la guerre
De la guerre
La guerre est le plus spectaculaire des phénomènes sociaux. “ L’homme est un loup pour l’homme ” : cette phrase de Plaute incarne l’idée que la guerre est naturelle. Nier cette assertion est délicat puisque l’histoire de l’Humanité n’est qu’un enchaînement de périodes de guerres et de paix, ce qui fait que Drukheim la considère comme “ l’histoire entendue d’une certaine façon ” puisque l’Histoire commence par être exclusivement l’histoire des conflits armés.
Ainsi la guerre serait consubstantielle à l’existence de l’humanité, indissociable de la condition humaine. Ancestralement, pour de multiples motifs tels la nourriture à se procurer pour assurer la survie, des territoires à conquérir au détriment du groupe voisin, des femmes et des enfants à voler… puis plus tardivement des discordes religieuses, tribales ou ethniques ; des motifs de succession ou d’indépendance par revendication de territoires, voir encore le contrôle des richesses pour assurer par l’accaparement l’indépendance énergétique de son pays, les alliances ou ententes entre Etats ou par nécessité d’un ennemi extérieur afin de créer ou renforcer l’unité nationale (théorie du bouc émissaire). Cette situation conflictuelle induit la problématique de la conquête et du droit de conquête entendu que le droit des relations internationales est d’abord le droit de la conquête.
La guerre est une question éminemment philosophie et Gaston Bouthoul fonde la polémologie, à savoir l’étude scientifique de la guerre considérée comme phénomène psychologique et social.
Le vocable de guerre interpelle. Mais qu’est-ce-que la guerre? Pendant longtemps, la guerre est pour les hommes un phénomène omniprésent de l’univers. Les guerres ne sont que des manifestations d’un télos, d’un mouvement universel. Ainsi Héraclite affirme que “ la guerre est le père de toutes choses ” alors que Hegel y voit le jeu de la dialectique et Voltaire remarque que “ tous les animaux sont perpétuellement en guerre les uns avec les autres ”.
Deux postulats philosophiques s’affrontent sur les causes de la guerre : le déterminisme et le libre-arbitre. Si l’univers est mû par la guerre, les hommes ne sont que les jouets d’une volonté aveugle qui les transcende : l’homme n’est pas responsable de ses actes. Les philosophes de la liberté soulignent la liberté humaine : la guerre est le produit d’un choix, donc les hommes en sont responsables.
La notion même de guerre juste est sujet à controverses suivant les époques ; ainsi Machiavel écrit qu’une “ guerre est juste quand elle est nécessaire ” de même Saint Thomas : une guerre “ est juste si sa cause est juste et qu’elle poursuit le Bien Commun ” alors que Chirac affirmera que “ La guerre, c'est toujours un ultime recours, c'est toujours un constat d'échec, c'est toujours la pire des solutions, parce qu'elle amène la mort et la misère. ”
Si le Droit international commence par être théologique, vient ensuite l’état métaphysique du droit international : aux Dieux se substituent des entités et des concepts absolus et péremptoires. C’est l’apothéose de l’Etat, la notion absolue et intangible de la souveraineté, la théorie du droit de conquête ou de premier occupant, du principe dynastique, aristocratique ou populaire et enfin l’hypostase de la nationalité ou de la race.
A côté du droit international théologique puis métaphysique, apparaît le droit international anthropomorphique, reflet des périodes monarchiques de l’histoire. Le droit médiéval fait de la souveraineté politique un bien patrimonial. La guerre est une querelle personnelle entre souverains ou une contestation entre dynasties. Les canons de Louis XIV portent gravée dans le bronze l’inscription : “ Ultima ratio regis ” - la guerre est le dernier argument du roi. Avec pour corollaire, le nombre d’auteurs qui au fil du temps s’intéressent à la notion de conquête et son corollaire le droit de conquête et permettent de saisir l’évolution de la pensée en ce domaine.
Deux éléments inhérents à la guerre apparaissent progressivement :
¤ La force – Cicéro qualifie la guerre d’“ affirmation par la force ”, Grotius ajoute que “ la guerre est l’état des forces en compétition ” alors que Diderot la voit comme “ une maladie convulsive et violente du corps politique ”.
¤ Les Etats ou les nations - Clausewitz considère que “ la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens ” et Webster la caractérise comme un conflit armé hostile entre Etats ou nations. Cette conception politico-rationaliste de la guerre suppose que la guerre n’existe qu’entre Etats, ce qui dénie la qualification de guerre aux guerres pré-étatiques, aux guerres civiles ou aux guerres entre un Etat (ou/et ses alliés) et un groupe terroriste.
La création de l’Organisation des Nations Unies, suite aux deux conflits mondiaux très meurtriers, avec pour finalité première la paix internationale, permet de penser un Droit International Public conventionnel mais n’empêche pas les conflits armés de proliférer.
Dans le même esprit, la création au niveau de l’Europe géographique : l’Union européenne permet une situation stable des Etats européens jusqu’aux guerres de l’ex-Yougoslavie entre 1991 et 2001.
La mondialisation bouleverse l’environnement stratégique contemporain, contribue à augmenter les inquiétudes sur le pouvoir de certains Etats à inciter certaines organisations terroristes à agir et génère des conséquences économiques qui affectent la planète. La chute du Mur de Berlin, la disparition deux ans plus tard de l’URSS et la montée en puissance du groupe des BRICS modifient l’échiquier mondial. Les référents politiques et idéologiques se transforment et l’on note un affaiblissement de l’hégémonie de l’Occident.
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, l’on note une destruction du Droit International Public en faveur des Etats les plus puissants au nom de la lutte contre le terrorisme. La lutte antiterroriste mondiale devient le lien qui relie la politique de l’exception permanente à l’Etat de droit.
Les guerres du XXIe siècle bouleversent notre appréhension de la notion de guerre puisqu’elles remettent en cause la définition même de la guerre entendue comme conflit armé entre Etats souverains, atténuent ou effacent dans les sociétés guerrières la distinction civil/combattant, génèrent une nouvelle victimologie bien que l’on note des constantes avec les précédentes guerres telles que la violence, la cruauté, la violation du DIP…
Si la nécessité d’un nouveau système international efficient d’une redéfinition des concepts juridique et du rôle de l’ONU en tant que porteur de normes interpelle, il faut remarquer qu’à ce jour, rien de concret à l’horizon par manque de courage politique… et la situation mondiale conflictuelle perdure.
LA NOTION DE GUERRE
LE PHENOMENE SOCIAL DE GUERRE
ELEMENTS DE DEFINITION
DOCTRINES ET OPINIONS SUR LA GUERRE
DOCTRINES THEOLOGIQUES
La Bible : l’Ancien Testament
Le Nouveau Testament
La théologie chrétienne
Le Coran
DOCTRINES PHILOSOPHIQUES
Les philosophes chinois
Les philosophes grecs et romains
Les panégyristes de la guerre
Les négateurs de la guerre
DOCTRINES PACIFISTES
Le pacifisme sacré
Le pacifisme : l’exclusion de la notion du sacré
Le pacifisme plaintif
DOCTRINES MORALES ET JURIDIQUES
L’Antiquité
Le droit biblique de la guerre
Le Moyen Age
Le droit de la guerre dans la pensée de la Renaissance
Les penseurs modernes et le droit de la guerre
DOCTRINES SOCIOLOGIQUES
Théories esthétiques
Les semi-apologistes
Les apologistes
ILLUSTRATION DE L’ESPRIT BELLIQUEUX HUMAIN
DE LA GUERRE CLASSIQUE « JUSTE »
HISTORICITE DE LA REFLEXION SUR LA GUERRE
L’idée de guerre avant Grotius
Hugo Grotius – De iure belli ac pacis (1625)
Carl von Clausewitz – Vom Krieg (1832) et Carl Schmitt – Théorie du partisan (1963)
Ern de Vattel – Droit des Gens ou Principes de la loi naturelle appliquée à la conduite et aux affaires des Nations (1758) et Cornélius Van Vollenhoven – Droit des Gens (1919)
Evolution de la construction doctrinale moderne
UNE SINGULARITE – LA QUALIFICATION JURIDIQUE DE LA |GUERRE IRREGULIERE"
DES GUERRES DU XXIE SIECLE
GUERRE ET DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
LA CHARTE DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES (1945) : LE CONSENSUS INTERNATIONAL EN FAVEUR DE LA PAIX
INTERVENTIONNISME EXTERIEUR ET DROIT ONUSIEN AU XXIE SIECLE
Utilisation du système normatif onusien
Droit onusien et ingérence humanitaire
Principe de non-ingérence, principe de non-recours à la force et droit des peuples à disposer d’eux-mêmes : des principes au service de la paix et de la sécurité internationales
L’application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies
La R2P – Responsability to protect – au titre du Chapitre VII : intervention encadrée
Droit onusien, guerre préventive et guerre préemptive
PARTICULARITES ET NOUVEAUX FACTEURS BELLIGENES
Typologie et cartographie
Quelque facteurs belligènes
Acteurs et armement
Le renseignement
La privatisation de la sécurité
Cyberguerres et cyberconflits
Victimologie
FAIRE LA PAIX
La médiation
Primum non nocere
LES PROFITEURS DE L'INSECURITE
De la théorie…
A la pratique