HISTOIRE DE LA PENSEE POLITIQUE MODERNE
Epoque moderne 1492-1789
Epoque contemporaine 1789...
Dr Valérie Ladegaillerie
ISBN 979-10-96025-41-1  Histoire pensee politique moderne
Histoire pensee politique moderne 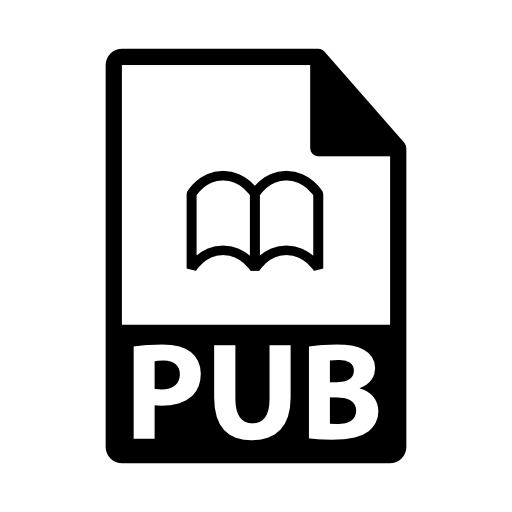 Histoire pensee politique moderne
Histoire pensee politique moderne
L'Histoire de la pensée politique moderne (1492/1789) et contemporaine (1789....) permet l'appréhension de l'évolution des notions et concepts.
L’apparition de la philosophie politique et des théories constitutionnelles qui fondent l’Etat démocratique et libérale caractérise les Temps modernes relativement aux idées politiques en Occident. Il faut observer que les penseurs antiques et médiévaux formulent déjà nombre des idées de base de cet Etat de droit.
Les penseurs de ces siècles construisent un nouvel ordre social qualifiable de modèle et de paradigme. Cette clef intellectuelle novatrice leur permet de décrire et de préconiser les institutions de l’Etat de droit ; institutions qui permettent de générer un ordre pluraliste : le droit abstrait et universel, les droits de l’homme, le marché, la démocratie, les institutions académiques libres, la presse libre… Puis, par un processus irrésistible, la supériorité conférée par ces institutions aux sociétés occidentales sur toutes les autres formes connues d’organisation sociale assure la pérennité du modèle démocratique et libéral. Celui-ci triomphe successivement des régressions successives que constituent le fascisme, le nazisme, le communisme… voire les dictatures militaires.
L’on peut discerner dans la pensée politique occidentale moderne, trois grandes familles de théories commandées par un paradigme fondamental : celle de la droite, celle de la gauche et celle de la démocratie libérale. Ainsi, le paradigme de l’ordre naturel commande la pensée de droite ; le paradigme de l’ordre artificiel, pensé ou construit commande la pensée de gauche et le paradigme de l’ordre spontané ou pluraliste caractérise la tradition démocratique et libérale.
Les questions du pouvoir dans l’Etat et du pouvoir de l’Etat sont fondamentales et l’histoire de la pensée politique des Temps modernes se confond avec l’élaboration des théories modernes de l’Etat. Les théories politiques tentent de répondre à l’une ou l’autre des deux grandes questions : qui doit détenir le pouvoir politique ? quelles doivent être les limites du pouvoir politique, quel que soit son détenteur ? A savoir résoudre soit la question du pouvoir dans l’Etat, soit la question du pouvoir de l’Etat.
L'absolutisme - La Renaissance voit la création en Europe de grands Etats-nations en rupture totale avec le morcellement territorial féodal hérité du Moyen Age. Les dirigeants et les penseurs de l’époque, tels Machiavel, Luther ou les Français Bodin, Bossuet… Le Bret, afin de justifier la situation, construisent sur la base du droit romain le concept d’un pouvoir absolu de l’Etat. Emergent les premières doctrines absolutistes avec la thèse de la légitimité du pouvoir absolu du monarque dans l’Etat et la thèse de la légitimité du pouvoir absolu de l’Etat sur la société. L’absolutisme est un type de régime politique où le détenteur d’une puissance attachée à sa personne concentre en ses mains tous les pouvoirs et gouverne sans aucun contrôle extérieur.
La tradition démocratique et libérale - Dès l’Antiquité et le Moyen Age, des doctrines affirment les principes de légitimité et de pluralisme en matière politique, économique et sociale. Par réaction aux doctrines absolutismes et contre la prétention des rois à gouverner seuls l’Etat, émergent les doctrines démocratiques qui revendiquent en particulier des droits politiques, le gouvernement représentatif et le suffrage universel.
La Révolution anglaise (1688) et la Révolution française (1789) ouvrent l’ère du capitalisme triomphant et du libéralisme. Le terme libéral recouvre des acceptions différenciées. Le vieux mot de libéral prend son acceptation politique sous le Consulat mais, vers 1815, il devient un mot clé de l’actualité politique qui parle de tendances libérales opposées à celles de l’Ancien Régime. Il faut constater que le programme des libéraux s’articule autour de deux préoccupations – le respect de l'individu et la garantie des droits de l'homme, droits antérieurs à toute organisation sociale ; la liberté de conscience, de parole, d'écriture, de propriété.
Les contradicteurs de la tradition démocratique et libérale - Dès le début du XIXe siècle, les critiques aux doctrines démocratiques et libérales prennent la forme de doctrines construites au moment où les régimes démocratiques et libéraux triomphent. Elles se subdivisent en deux familles, la gauche dite progressiste et la droite dite réactionnaire. Cette opposition prône une forme de société où le groupe prime l’individu et où les rapports humains intangibles se caractérisent par le refus de la société ouverte.
La droite réactionnaire prône le retour aux communautés naturelles et le corporatisme. Elle se réfère à un ordre naturel ou providentiel dont on n’aurait jamais du s’écarter et rejette les principales institutions telles la démocratie et le libéralisme, l’Etat de droit, l’économie de marché, la liberté de penser et l’idée de progrès puisque la nature est immuable.
La gauche qui se définit comme progressiste entend supprimer les structures sociales ayant permis le progrès et conserver les acquis scientifiques, techniques et économiques mais veut échapper à la société nouvelle par une révolution. Utopique, elle pose qu’il n’existe que d’ordre pensé et construit et prône le socialisme organisateur et planificateur.
AVANT-PROPOS
PARTIE I L'ABSOLUTISME
- L'ABSOLUTISME DANS LES ETATS AU MOYEN-AGE
- LES THEORICIENS DE L'ABSOLUTISME
- L'ABSOLUTISME FRANÇAIS AUX XVIIE-XVIIIE SIECLES
PARTIE II LA TRADTION DEMOCRATIQUE ET LIBERALE
- LES PARTICULARISMES DU XVIE SIECLE
- DES REPUBLIQUES HOLLANDAISES
- L'IDEOLOGIE POLITIQUE DE L'ANGLETERRE
- L'IDEOLOGIE POLITIQUE DE LA REVOLUTION AMERICAINE
- L'IDEOLOGIE POLITIQUE DE LA FRANCE
- L'IDEOLOGIE POLITIQUE DE L'ALLEMAGNE
PARTIE III LES CONTRADICTEURS DE LA TRADITION DEMOCRATIQUE ET LIBERALE
- GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
- LES CONTRADICTEURS CONSERVATEURS
- LES CONTRADICTEURS PROGRESSISTES
ANNEXES